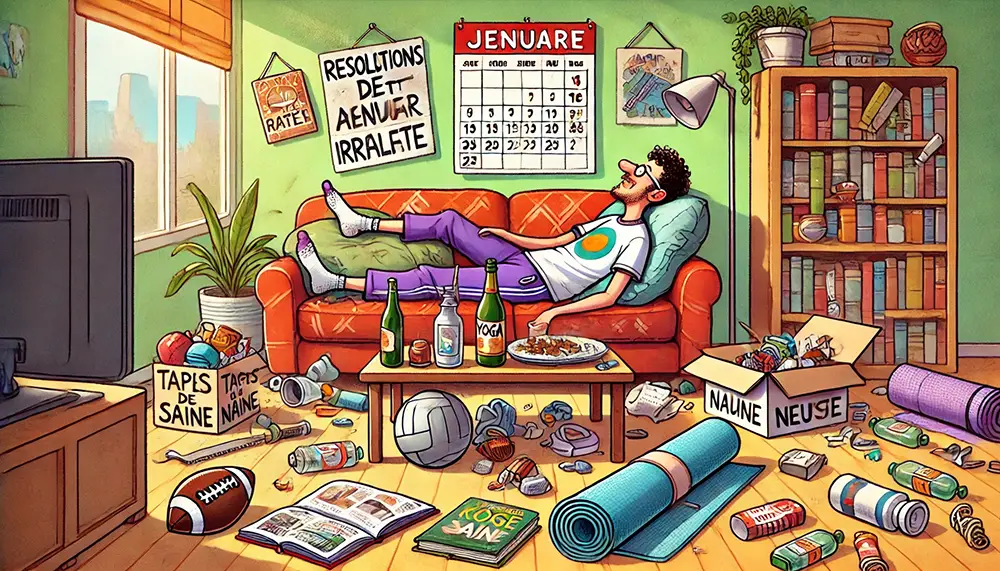Le 1er janvier, tout le monde y croit. On se lève gonflé à bloc, prêt à transformer sa vie en une version améliorée de soi-même. Puis, une semaine plus tard, c’est l’échec total. Pourquoi ? Parce que certaines résolutions sont aussi crédibles qu’un régime à base de chocolat. Plongée dans ces promesses illusoires, vouées à s’écrouler comme un château de cartes.
D’où viennent ces résolutions de début d’année ?
Les résolutions de début d’année ne datent pas d’hier. Cette tradition trouve ses origines il y a plusieurs millénaires. Les Babyloniens, il y a environ 4 000 ans, furent les premiers à instaurer une forme de promesse annuelle. Lors du festival d’Akitu, ils rendaient hommage à leurs dieux en jurant de rembourser leurs dettes et de rendre les objets empruntés. L’idée ? Gagner les faveurs divines pour assurer de bonnes récoltes. Un mélange de superstition et de pragmatisme.
Un peu plus tard, les Romains ont repris le flambeau. Sous Jules César, le mois de janvier, dédié au dieu Janus (le dieu des portes et des commencements), devint l’occasion idéale pour réfléchir à ses erreurs passées et se projeter dans l’année à venir. Ces résolutions, bien qu’essentiellement spirituelles à l’époque, servaient aussi à montrer qu’on était une personne honorable. L’hypocrisie avait déjà ses racines.
Au fil des siècles, la dimension religieuse a persisté. Pendant le Moyen Âge, par exemple, les chevaliers formulaient des vœux de renouveau moral lors des fêtes chrétiennes. Promettre d’être meilleur était un passage obligé, même si, soyons honnêtes, l’application laissait souvent à désirer.
Aujourd’hui, ces résolutions ont pris une tournure plus individuelle et commerciale. Les réseaux sociaux débordent de conseils pour « réinventer sa vie » : des influenceurs promettent des miracles avec un abonnement à leur programme, tandis que les publicités martèlent l’idée que janvier est synonyme de changement. Finalement, ces promesses modernes s’inscrivent dans une longue tradition de bonnes intentions, mais elles s’accompagnent d’une pression supplémentaire : celle de la perfection mise en vitrine.
En somme, les résolutions de début d’année sont un cocktail de rituels historiques, de morale sociale et de marketing contemporain. Mais peu importe leur origine : elles continuent d’échouer avec une constance impressionnante.
Pourquoi les français prennent-ils des résolutions ?
La nouvelle année, souvent perçue comme un nouveau départ, est l’occasion idéale pour beaucoup de se fixer des objectifs. Que ce soit pour améliorer sa santé, sa situation professionnelle ou ses relations personnelles, les résolutions de début d’année reflètent nos aspirations profondes.
Cependant, une étude récente révèle que seuls 33 % des Français prennent des résolutions en 2024, contre 86 % en 2023. Cette baisse pourrait s’expliquer par une forme de réalisme ou de fatigue face aux échecs répétés. En effet, plus de 87 % des Français admettent ne pas réussir à les tenir.
Évolution des résolutions en 2019, 2023 et 2024
| Année | Résolution principale | Pourcentage | Taux de succès estimé |
|---|---|---|---|
| 2019 | Réduction du stress | 60 % | 15 % |
| 2023 | Plus d’activités physiques | 41 % | 13 % |
| 2024 | Sport et alimentation saine | 51 % | 12 % |
Voici les 10 résolutions les plus courantes difficiles à tenir
« Cette année, je me mets au sport »

Ah, le classique des classiques. L’inscription dans une salle de sport bondée dès le 2 janvier, les baskets flambant neuves et une tenue assortie. Pendant trois jours, vous suivez scrupuleusement un programme trouvé sur Instagram. Mais rapidement, la réalité s’impose : transpirer, c’est fatigant.
Les excuses pleuvent : « Je n’ai pas le temps », « Je suis courbaturé », ou encore « J’attends la semaine prochaine ». Spoiler : la semaine prochaine n’arrivera jamais. Et les salles de sport ? Elles se frottent les mains devant votre abonnement annuel payé en vain.
« Je vais arrêter de fumer »
Celle-ci mérite un prix pour son optimisme délirant. Vous achetez des patchs, des chewing-gums à la nicotine, et vous vous convainquez que cette fois, c’est la bonne. Le 3 janvier, vous tenez bon, même en croisant un collègue qui fume dehors. Le 5 janvier, une journée stressante suffit pour allumer « juste une ». Résultat ? Le paquet est vide avant la fin de la semaine.
Mais ne vous inquiétez pas. Vous vous direz que le 1er février est aussi une bonne date pour commencer. Spoiler numéro deux : ce n’est pas le cas.
« Je me mets au yoga pour être zen »
Vous commandez un tapis éco-responsable et suivez une vidéo de « yogi lifestyle« . Pendant deux jours, tout est parfait : vous respirez, vous étirez, vous méditez. Mais dès que la vie reprend son rythme normal, le yoga passe à la trappe.
Trop fatigué le matin. Pas assez calme le soir. La méditation ? Remplacée par un défilement frénétique sur TikTok. Après une semaine, le tapis de yoga devient un dessous de lit de luxe. Namasté.
« Je vais manger sainement »
Adieu burgers, bonjour quinoa. Le frigo déborde de légumes bios, d’avocats et de lait d’amande. Les trois premiers repas sont une ode au bien-être. Mais très vite, la fatigue d’éplucher des légumes s’installe. Les recettes trop saines manquent de saveur.
La vérité, c’est qu’après une journée stressante, un bol de soupe ne rivalisera jamais avec une pizza. Et voilà comment vous retrouvez chez votre fast-food préféré dès le 6 janvier. Hypocrisie totale : « juste une fois ». Bien sûr.
« Je vais être plus organisé »
Cette résolution ressemble à un vœu pieux. Vous achetez un agenda, créez des listes interminables et regardez des vidéos sur la productivité. Pendant quelques jours, ça marche. Vous cochez des cases, suivez un emploi du temps rigide.
Puis arrive l’imprévu : un email urgent, un retard, une mauvaise nuit. Votre organisation s’effondre comme un château de cartes. L’agenda finit oublié au fond d’un tiroir. Et votre « organisation » ? Revenez l’année prochaine.
« Je vais apprendre une nouvelle langue »
Dites bonjour à Duolingo ! Vous téléchargez l’application, super motivé pour apprendre le japonais ou l’espagnol. Les premiers jours, vous collectionnez les « flammes » et les félicitations virtuelles. Ensuite, la lassitude s’installe.
Les notifications insistantes : ignorées. Votre motivation initiale ? Volatilisée. À la fin de la semaine, vous ne savez dire que « Hola » ou « Konnichiwa ». Et encore.
« Je passe moins de temps sur les écrans »

C’est beau comme résolution. Vous activez les limites d’écran sur votre téléphone, supprimez les applis inutiles et promettez de lire un vrai livre. Résultat ? Vous vous retrouvez à contourner vos propres restrictions.
Chaque notification devient irrésistible. Et au lieu d’un roman, vous passez encore trois heures à scroller sur Instagram. Ironie ultime : vous googler « comment moins procrastiner ».
« Je dépense moins et je mets de l’argent de côté »
L’idée semble raisonnable. Vous établissez un budget, renoncez aux petits plaisirs inutiles et vous ouvrez un compte épargne. Pendant quatre jours, vous vous sentez fier de vous. Ensuite, une promo apparaît.
Un dîner entre amis, un gadget inutile mais cool, et hop ! Le compte en banque crie déjà famine. Conclusion : les bonnes intentions ne pèsent jamais lourd face au pouvoir d’une réduction à -50 %.
« Je réduis ma consommation d’alcool »
Vous annoncez fièrement à vos amis : « Je me mets à l’eau pétillante ». Les premiers jours, vous tenez bon, esquivant habilement les invitations à boire un verre. Mais très vite, un anniversaire ou un afterwork vient ruiner votre résolution.
Un verre, puis deux. Et soudain, vous réalisez que votre « modération » est déjà morte. Vous riez : « Je ferai Dry January l’année prochaine ». On y croit.
« Je passe plus de temps avec ma famille »
Cette résolution démarre toujours avec des appels enthousiastes. Vous promettez de venir dîner plus souvent, de passer des après-midis avec vos parents. Sauf que, dès le 4 janvier, la vie reprend son cours.
Les excuses fusent : « Pas le temps », « Beaucoup de travail », ou « Je me rattraperai ce week-end ». Et au final ? Rien ne change.
Pourquoi ces résolutions échouent ?
Prendre des résolutions, c’est bien, mais les réaliser, c’est une autre histoire ! Le problème principal : elles sont irréalistes. Changer radicalement son mode de vie du jour au lendemain, c’est impossible.
Plusieurs facteurs expliquent ces échecs récurrents :
- Manque de suivi : Beaucoup de Français abandonnent leurs efforts après quelques semaines faute de stratégie ou de soutien.
- Ambitions irréalistes : Fixer des objectifs trop ambitieux sans étapes intermédiaires est une erreur fréquente.
- Absence de motivation durable : La vie quotidienne reprend vite le dessus, reléguant les résolutions au second plan.
Comment s’en sortir ?
- Soyez réaliste
Arrêtez de viser la perfection. Mieux vaut une petite amélioration durable qu’un grand projet voué à l’échec. - Avancez pas à pas
- Fixez-vous des étapes simples
Par exemple, remplacer un seul repas par semaine par un plat sain. Pas tout d’un coup. - Faites-le pour vous
Si la motivation vient de la pression sociale, oubliez. Les changements sincères sont toujours plus efficaces. - Trouvez un accompagnement
Selon les sondages, 54 % des Français aimeraient être soutenus dans leurs démarches. Cela peut prendre la forme d’un coach, d’un programme collectif ou même d’une application dédiée. - Entourez-vous de partenaires
Travailler en groupe ou en famille permet de rester motivé et de se soutenir mutuellement.
Conclusion
Les résolutions de début d’année sont souvent des mensonges que l’on se raconte pour bien démarrer. Mais, soyons honnêtes, elles finissent généralement à la poubelle avant même la fin de la première semaine. D’ailleurs, le recul du nombre de Français prenant des résolutions reflète peut-être une évolution des mentalités. Fini le temps des promesses non tenues, place à des objectifs plus modestes mais réalistes. Toutefois, cet apparent désengagement cache une volonté de mieux faire. Les Français souhaitent agir, mais de manière plus réfléchie et moins impulsive.
Alors, cette année, pourquoi ne pas essayer autre chose : ne rien promettre, et simplement faire de son mieux. C’est moins glamour, mais bien plus réaliste.